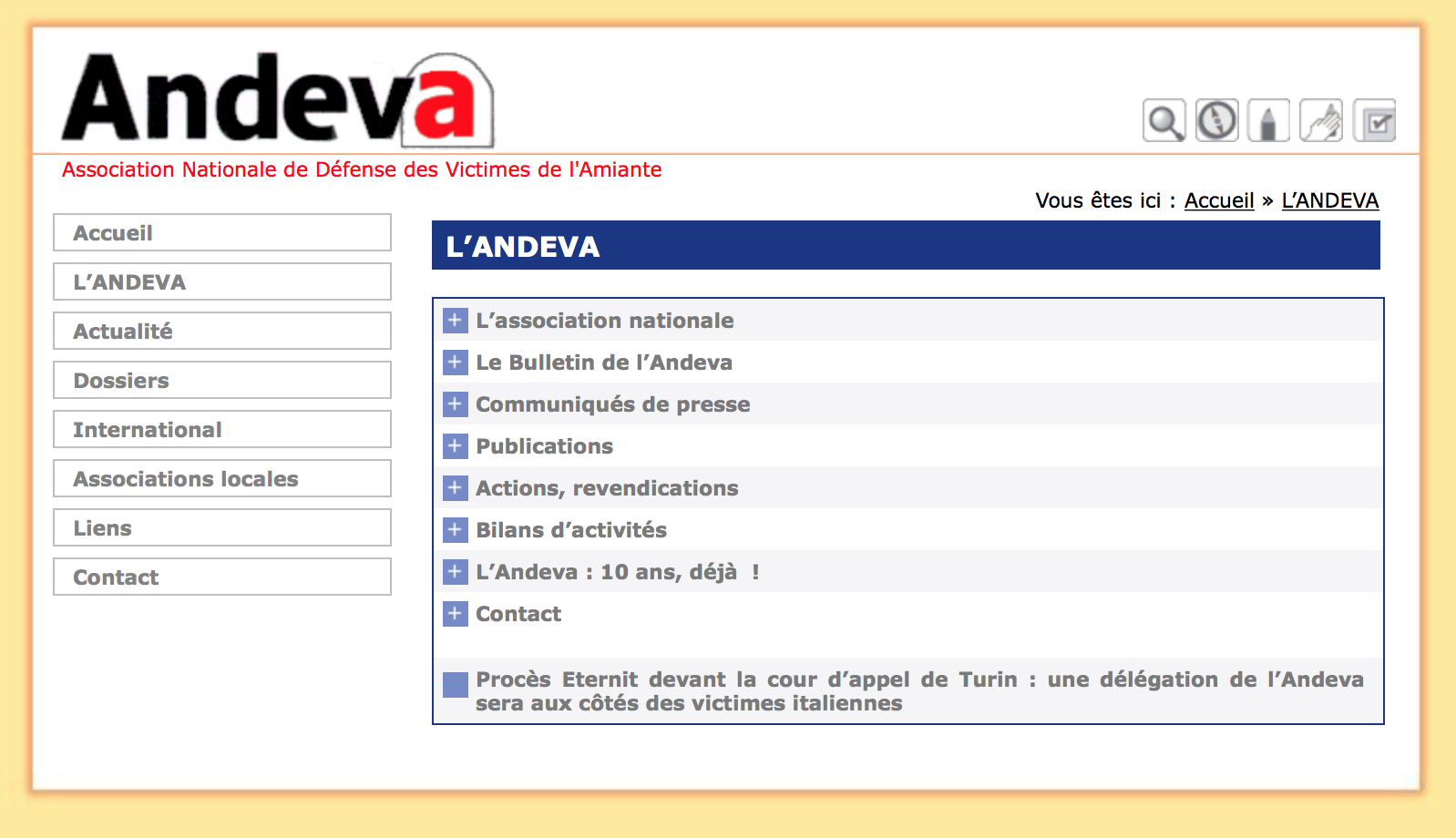François Lafforgue a plaidé de nombreux dossiers concernant l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Il l’a fait, devant les juridictions les plus diverses : tribunaux administratifs, conseils de prud’hommes, tribunaux des affaires de Sécurité sociale, cours d’appel...
Un contentieux multiforme, riche d’enseignements, dont il tire ici les leçons, en prenant du recul sur l’actualité immédiate.
« Ces combats ont permis de corriger des injustices et d’ouvrir de nouvelles voies pour la prévention des risques au travail »
Quelles ont été les premières procédures après la création de l’Acaata ?
Dès les premiers arrêtés des employeurs ont voulu faire radier certains établissements. Sans succès le plus souvent..
A l’inverse, des associations de l’Andeva et des syndicalistes ont demandé l’inscription d’établissements qui ne figuraient pas sur les listes.
Au début les litiges étaient traités directement par le Conseil d’Etat, puis ils ont été traités par les tribunaux administratifs, en première instance.
La jurisprudence du conseil d’État a évolué favorablement : il a ainsi validé l’inscription d’entreprises spécialisées dans l’isolation (flocage, calorifugeage), mais aussi d’entreprises non spécialisées dont « une part significative de l’activité » était constituée des opérations de calorifugeage-décalorifugeage sur des tuyauteries ou des fours par exemple. Il a pris en compte la réalité de l’activité et pas simplement la raison sociale de l’établissement .
Ont donc été inscrites des entreprises sidérurgiques comme Focast à Saint-Dizier ou Sadefa à Fumel, des verreries comme celle de Masnières (Nord), celle de Vianne (Sud-Ouest), ou Saint-Gobain Isover à Chalon-sur-Saône, ainsi que des établissements de chimie lourde comme Arkema (Golfe de Fos, Digne, Grenoble).
A partir de 2003, le ministère a opposé une résistance acharnée à l’inscription de nouveaux établissements. Pour l’aciérie Aubert et Duval, il a même bafoué une décision de justice confirmée par la Cour d’appel et le Conseil d’État, Il y a des différences de traitement injustifiables pour un même secteur d’activité.
L’inscription de sociétés sous-traitantes est difficile.
Oui. Deux types de procédures ont été engagées :
Devant les tribunaux des affaires de Sécurité sociale, nous avons contesté les refus des caisses régionales d’accorder le bénéfice de l’Acaata à des salariés, Devant les tribunaux administratifs, nous avons contesté le refus du ministère d’inscrire ces établissements.
Les recours collectifs contre le refus d’inscrire ces établissements ont eu des fortunes diverses.
Quand l’activité principale de l’entreprise sous-traitante consistait à faire travailler ses salariés au sein d’entreprises utilisatrices inscrites pour des travaux de chaudronnerie par exemple, des inscriptions ont pu être obtenues. Par exemple pour les entreprises sous-traitantes de la DCN de Cherbourg : SNC, Leroux et Lotz, GIMT…
Mais il n’a pas été possible de faire inscrire des sociétés intervenant sur des sites divers comme les sociétés de nettoyage qui peuvent assurer le ménage dans un chantier naval où il y a de l’amiante mais aussi dans des bureaux où il n’y en a pas.
Les recours individuels devant les Tass ont échoué : les tribunaux ont jugé que la loi de 1998 réservait l’Acaata aux seuls salariés d’un établissement figurant sur les listes.
Une loi de décembre 2009 a ouvert à tout citoyen la possibilité de poser une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) s’il estime qu’une disposition légale est contraire à la Constitution.
Une QPC a donc été posée au Conseil constitutionnel : des salariés en sous-traitance travaillent sur le même site, dans les mêmes ateliers que ceux de l’entreprise utilisatrice qui bénéficient de l’Acaata.
Ils respirent les mêmes poussières, sont atteints par les mêmes maladies mais n’ont pas les mêmes droits ! Cette rupture d’égalité est-elle conforme à la Constitution ?
La Cour de cassation dira en avril si elle juge légitime la transmission de cette question au Conseil constitutionnel.
Des recours portent sur la période de référence...
La date de départ en « pré-retraite amiante » dépend du nombre d’années travaillées durant une période d’exposition à l’amiante fixée par arrêté.
Ainsi, pour les dockers du Port autonome de Rouen la période de référence se terminait en 1997. Or la présence d’amiante a perduré après cette date dans les cales des navires de fret.
Nous avons obtenu l’extension de cette période.
Il y a des contentieux sur le montant de l’allocation
En règle générale, ce montant est calculé à partir du salaire de référence des douze derniers mois travaillés. Certaines CRAM refusaient de prendre en compte des éléments de revenu tels que les RTT ou les congés payés non pris. Nous avons contesté. En 2007 la Cour de cassation nous a donné raison. Mais des CRAM ont bafoué délibérément ces arrêts, suivant en cela les directives des autorités de tutelle.
Fin 2009, le gouvernement a changé les règles du jeu par décret. Désormais ne seraient plus pris en compte les éléments de revenu « n’ayant pas un caractère régulier et habituel ».
Nous avons alors saisi de nouveau les juridictions pour les demandes d’allocation déposées avant 2010. Elles nous ont presque toujours donné raison.
D’autres actions ont porté sur le calcul du salaire de référence
La loi prévoit une disposition particulière pour les salariés qui ont quitté un établissement inscrit sur les listes dans le cadre d’un licenciement économique : Pour eux, le salaire de référence peut être soit le salaire actuel (celui du dernier employeur) soit l’ancien salaire (celui de l’entreprise qui les a licenciés). Il faut prendre le plus favorable.
Après leur licenciement, certains ont retrouvé un travail moins bien payé. Pour eux, la base de calcul doit être l’ancien salaire revalorisé. Certaines CRAM ne le font pas. Nous engageons alors un recours et les cours d’appel leur imposent de recalculer l’allocation, comme l’a fait celle de Nancy .
A l’inverse, d’autres salariés ont trouvé un emploi mieux payé après avoir été licenciés. Pour eux, la base de calcul devrait être le dernier salaire. Or des CRAM ont opposé un refus à des salariés affiliés à un régime spécial de Sécurité sociale (régime agricole, Fonction publique) après avoir été affiliés au régime général. La cour d’appel de Riom les a obligées à prendre en compte le dernier salaire.
Des ouvriers du bâtiment ont, eux aussi, été lésés par un mode de calcul qui ne tenait pas compte des particularités du BTP. Des CRAM excluaient l’indemnité compensatoire de congés payés (versée par la caisse du Bâtiment), et incluaient l’abattement de 10%. Les cours d’appel les ont obligées à rectifier.
Le contentieux devant les juridictions prud’homales sur le préjudice d’anxiété a été le plus médiatisé.
A l’origine, ce combat judiciaire a été porté par des anciens salariés de ZF Masson, dans l’Yonne. Ils n’acceptaient pas que leur départ en Acaata se traduise pour eux par une baisse de revenu et pour l’employeur fautif par un avantage financier. Et devant le conseil de Prud’hommes ils ont dit que c’était à l’employeur de prendre en charge la perte de revenu.
A leur tour, des salariés d’Alsthrom à Bergerac ont demandé l’indemnisation de ce préjudice économique mais aussi celle d’un préjudice d’anxiété, dû à la crainte de contracter une maladie grave.
Les uns et les autres ont eu gain de cause, d’abord devant les conseils de prud’hommes de Sens et de Bergerac, puis devant les cours d’appel de Paris et de Bordeaux.
Le 10 mai 2010, la Cour de cassation a cassé les arrêts des cours d’appel sur le préjudice économique, estimant que les juridictions prud’homales ne pouvaient ajouter au dispositif légal instituant l’Acaata. Mais elle a confirmé l’existence d’un préjudice d’anxiété dans un arrêt de principe.
Les cours d’appel de renvoi de Toulouse et de Paris (autrement constituée) ont pris une position identique. La cour d’appel de Paris a innové en reconnaissant un préjudice de bouleversement dans les conditions d’existence. Dans cet arrêt du premier décembre 2011, elle précise que les projets de vie des salariés exposés s’en trouvent « irrémédiablement et quotidiennement affectés par une amputation de leurs projets de vie ».
Ce préjudice a été reconnu depuis par plusieurs juridictions prud’homales (Vienne, Saint-Etienne, Grenoble) et par la cour d’appel d’Agen .
L’anxiété et les troubles dans les conditions d’existence sont en fait deux composantes d’un préjudice de contamination.
La portée de ces arrêts est considérable.
Ils permettent de sanctionner financièrement l’employeur fautif sans attendre que la maladie apparaisse plusieurs décennies après l’exposition. C’est une incitation forte à renforcer la prévention.
Ceux qui sont en « pré-retraite amiante » ne sont pas les seuls concernés
En effet, au cours de ce long parcours judiciaire, nous avons soutenu que ces préjudices trouvaient leur origine non dans le départ en Acaata, mais dans la contamination par l’amiante. Les salariés qui renoncent à partir en Acaata pour des raisons financières subissent les mêmes préjudices
Cette jurisprudence doit pouvoir s’appliquer à tous les produits toxiques à effet différé. Le 30 novembre 2010 la cour de Cassation a fait droit aux demandes d’un intérimaire exposé au chrome. Malgré l’absence de maladie déclarée, elle a jugé son recours légitime, l’employeur n’ayant pas respecté ses obligations de sécurité,
Au fil des années, on a vu se dessiner une certaine cohérence dans l’évolution de la jurisprudence.
Les arrêts de la cour de cassation du 28 février 2002 sur « l’obligation de sécurité de résultat » pèsant sur l’employeur ont ouvert la voie.
La reconnaissance au civil du préjudice d’anxiété prolonge en fait la condamnation pénale d’Alstom en mars 2008 par la cour d’appel de Douai pour « mise en danger de la vie d’autrui ». La cour avait alors indemnisé le préjudice d’anxiété de 160 plaignants non malades exposés aux poussières d’amiante par la faute de leur employeur.
Ces procédures auront-elles des effets sur le niveau des indemnisations des salariés malades de l’amiante ?
Elles devraient logiquement conduire à une revalorisation des indemnités des personnes malades de l’amiante.
C’est l’argumentation que nous avons développée à Clermont et à Toulon. Les magistrats nous ont entendus.
_____________________________________
Article paru dans le bulletin de l’Andeva n°39 (mai 2012)